Un instrument d’analyse et de mesure
du handicap en quatre dimensions
Selon le Système d’Identification et
de Mesure du Handicap « S.I.M.H. »
(Paris, Porto, Montréal, Tunis,
Jérusalem, Padoue, Belgrade)
Handitest : présentation
Le Handitest francophone
Liste complète des items du système d’identification du handicap
Les dérivés du handitest (formes abrégées ou pour une application spécifique)
HANDICAP
|
INTRODUCTION
Pour mesurer le handicap, il convient d’abord de le définir.
Les identifications par pathologies (handicap neurologique, pneumologique, rhumatologique, etc.) de même que celles par groupe d’organes ou de fonctions (handicap cardiaque, mental, psychique, visuel, auditif, sensoriel, moteur, viscéral, etc.) ne conviennent pas pour caractériser un phénomène qui, certes peut être relié à un mauvais état de santé d’origine corporelle ou mentale, mais qui est, avant tout, un phénomène social et subjectif.
C’est de la collaboration entre le Service de Réadaptation médicale (Médecine Physique et de Réadaptation MPR) du C.H.U. Henri Mondor (AP-HP) et la Ville de Créteil que le concept de situation de handicap s’est élaboré.
Il s’agissait d’expliquer aux urbanistes, de façon simple, comment aménager l’environnement pour qu’il ne soit pas un obstacle aux usagers de la ville. Cette analyse « situationnelle » permettait d’apporter des solutions communes aux difficultés rencontrées, face à un escalier ou à tout autre obstacle environnemental, aussi bien par un insuffisant respiratoire qu’un coxarthrosique ou un paraplégique.
Ainsi, une typologie des situations handicapantes a pu être établie et a fait l’objet d’une thèse de Médecine sur le handicap physique et la ville, soutenue à la Faculté de Médecine de Créteil , en 1974.
C’est sur ce concept de situation de handicap ou mieux de « situation handicapante » que s’est construite une approche, d’abord tridimensionnelle (lésions – fonctions – situations, Cl. Hamonet, 1983), puis quadridimensionnelle (le corps, les capacités, les situations et la subjectivité, Cl. Hamonet et Teresa Magalhães, 1998). Elle s’appuie sur des définitions précises et sans ambiguïté de ces quatre niveaux ; elle ne comporte aucun élément négatif ou stigmatisant ; elle utilise un langage simple, facile à interpréter, en facilitant la diffusion et la compréhension. Enfin, elle inclut la participation active de l’intéressé à sa propre évaluation, la personne humaine étant au centre même du système. Elle est dans la même mouvance que les propositions de Pierre Minaire et de son équipe sur les « handicaps de situation » (étude de la population de Saint-Cyr-sur-le-Rhône, 1984).
Cette nouvelle approche du handicap introduit, pour les Médecins et les professionnels de la santé, une nouvelle approche sémiologique (ou sémiotique) qui facilite considérablement leur appréhension de la personne malade, handicapée, ou en état de « mal-aise » (René Dubos). Pour les sciences humaines et le cadre sociétal et environnemental, elle introduit une nouvelle perception des interactions individu-société et un lien nécessaire entre la santé et la société.
DEFINITIONS ET SCHEMA CONCEPTUEL SUR
LESQUELS S’APPUIE LA NOTION DE HANDICAP
1-DÉFINITIONS
A - Le corps
Ce niveau comporte tous les aspects biologiques du corps humain, avec ses particularités morphologiques, anatomiques, histologiques, physiologiques, génétiques et génomiques.
Certaines modifications du corps, d’origine pathologique (maladie ou traumatisme) ou physiologiques (effets de l’âge, grossesse…), peuvent entraîner des limitations des capacités. On voit donc que les modifications pathologiques ne sont pas les seules en cause.
B - Les capacités
Ce niveau comporte les fonctions physiques et mentales (actuelles ou potentielles) de l’être humain, compte tenu de son âge et de son sexe, indépendamment de l’environnement où il se trouve.
Les limitations des capacités (réelles ou supposées), propres à chaque individu, peuvent survenir à la suite de modifications du corps mais, aussi, du fait d’altérations de sa subjectivité.
C - Les situations de la vie
Ce niveau comporte la confrontation (concrète ou non) entre une personne et la réalité d’un environnement physique, social et culturel.
Les situations rencontrées sont : les actes de la vie courante, familiale, de loisirs, d’éducation, de travail et de toutes les activités de la vie, y compris les activités bénévoles, de solidarité et de culte, dans le cadre de la participation sociale.
D - La subjectivité
Ce niveau comporte le point de vue de la personne, incluant son histoire personnelle, sur son état de santé et son statut social.
Il concerne tous les éléments subjectifs qui viennent compromettre ou supprimer l’équilibre de vie de la personne. Il représente le vécu émotionnel des événements traumatisants (circonstances d’apparition et d’évolution, annonce et prise de conscience de la réalité des faits et acceptation de vivre avec sa nouvelle condition).
2-SCHÉMA CONCEPTUEL
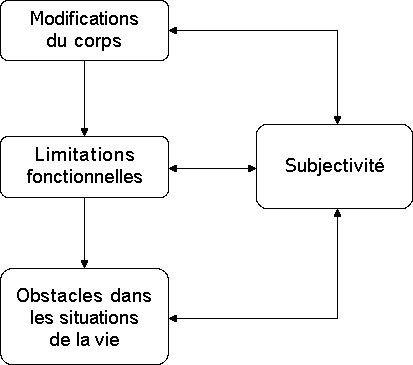
3-LA PERSONNE ET LE HANDICAP

PRESENTATION DU « HANDITEST »
Sa forme actuelle est le résultat de plusieurs étapes successives. La première (1982) a été le « handiscope ». Il avait un inconvénient majeur : la longueur du remplissage. La deuxième a été le « Handicapomètre D.A.C » (dépendance - autonomie - capacités) qui a été largement diffusé et appliqué en pratique de Médecine Physique et de Réadaptation et en expertises médico-légales et médico-sociales. Il a été largement validé depuis l’Université Paris 12 Val-de-Marne, l’Hôpital Henri Mondor et depuis l’Institut Médico-Légal de Porto par le Professeur Teresa Magalhães.
Le terme de « Handicapomètre » (mètre vient de métrologie, c’est-à-dire « Science de la mesure ») est mal accepté, en dehors des milieux scientifiques. C’est pourquoi nous avons préféré « Handitest », plus banalisé, en espérant qu’une nouvelle mode langagière ne vienne pas le discréditer ou le rendre stigmatisant.
Il peut être complété par l’utilisation d’items supplémentaires d’identification de la personne et des situations de la vie qui peuvent être retrouvés sur les listes établies par le « Système d’identification et de mesure du handicap, SIMH », Éditions ESKA, Paris. Elles ont été établies avec la collaboration de Marie de Jouvencel, neuropsychologue à Richebourg, et du Professeur Louise Gagnon, de l’Université de Montréal.
D’autres améliorations ont été apportées, notamment avec l’intervention du Professeur Catherine Dziri, de la Faculté de Médecine de Tunis avec son équipe du Service de Médecine Physique de l’hôpital Mohamed Kassab, à Kassar Said et du Professeur Lotfi Lallahoum et du Docteur Mejda Hamadi, à l’Institut de Promotion des handicapés du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité à Tunis. Une forme "abrégée" du Handitest a été mise au point avec cette équipe dans un but d’orientation rapide et simplifiée. L’usage du Handitest comme instrument d’autoévaluation a commencé à se diffuser et est conforté par le travail de Dimiri Théopoulos qui a réalisé (2005) un handi-aide, dérivé du Handitest pour l’évaluation des besoins en aides humaines à domicile, et d’une façon plus générale dans la vie sociale, à remplir par la personne elle-même.
On dispose ainsi d’une méthode polyvalente, applicable à toutes les personnes en situation de handicap, quels que soient l’âge et l’origine de l’état fonctionnel de la personne et quelles que soient les situations handicapantes.
C’est dire que les champs d’application sont aussi bien le domaine médical que le domaine social et, surtout, le domaine médico-social.
On dispose ainsi d’une méthode uniformisée et univoque de mesure du handicap quelle qu’en soit l’origine, qui doit en faciliter la compréhension, souvent diversifiée, selon le cadre de l’évaluation (de soins, de réadaptation, administratif, médico-légal, social…).













